Carnets de pédagogie pratique n° 326, collection Bourrelier, Armand Colin.
Introduction : Nécessité et urgence d'une pédagogie moderne (ci-dessous)
1. Les techniques Freinet de l'école moderne
2. La pratique des techniques Freinet
3. D'une classe à l'autre
4. Les méthodes naturelles de l'école moderne
5. Contre la sclérose des techniques Freinet
Les Techniques Freinet de l'Ecole Moderne 9
Comment se pose le problème 12
Les débuts de nos techniques 15
L'Imprimerie à l'école ........... 18
Naissance du texte libre ........ 21
Correspondance interscolaire motivée 23
La pédagogie de l'explication superflue 25
Une méthode naturelle d'éducation 30
Des techniques de travail ...... 34
Un esprit Freinet .................... 38
Cliquez sur une image
pour afficher en mode diaporama.
I
A temps nouveaux pédagogie nouvelle
LES TECHNIQUES FREINET
DE L'ÉCOLE MODERNE
DE L'ÉCOLE MODERNE
Nous n'aurons pas la prétention de dire que notre pédagogie vient à son heure, mais, plus simplement, qu'elle marque un tournant dans les soucis éducatifs. En face des problèmes suscités par la démocratisation de l'enseignement et les nécessités de rendement, les solutions théoriques de naguère sont aujourd'hui dépassées. L'ère de la technique est ouverte pour l'enseignement, comme elle l'est depuis longtemps pour tous les autres aspects de l'activité humaine.
Nous avons connu des périodes, entre les deux guerres notamment, où les méthodes pédagogiques semblaient partir concuremment à l'assaut des problèmes que posaient les ébranlements profonds d'un monde en devenir. Mme Montessori affirmait sa royauté; la méthode Decroly introduisait dans les circuits éducatifs les éléments insoupçonnés du globalisme; à Genève, une équipe de savants comme on n'en connaîtra peut-être plus jamais d'aussi dynamiques, orientait et activait les recherches avec Pierre Bovet, Claparède, Ad. Ferrière, Alice Descceudres et les seuls survivants actuels : Robert Dottrens et Jean Piaget. En Amérique, le Plan Dalton apportait aux étudiants une technique qui a été peut-être trop délaissée. Wash-burne innovait pratiquement. Les Allemands à Hambourg tentaient une expérience totale de self-government, vite abandonnée. Vienne restait un moment à l'avant-garde, avec l'U.R.S.S. qui expérimentait audacieusement dans un contexte social enthousiasmant.
Et brusquement, tout semble s'être évanoui : la méthode Montessori, trop figée dans ses normes soi-disant
9
scientifiques, esclave d'un matériel immuable, ne répond plus aux impératifs de notre siècle; Decroly a été trahi par tous ceux qui, en Belgique comme en France, ont scolastisé la méthode globale dont la caricature est aujourd'hui dénoncée comme un danger public; l'Ecole de Genève s'est disloquée. La disparition d'Ad. Ferrière, et aussi la détérioration à Genève d'un climat social désormais peu propice aux nouveautés, rendent le travail difficile aux derniers survivants de pédagogues éprouvés. Les U.S.A. ont exagéré et perverti les tendances libérales de l'Education nouvelle qui apparaissent parfois comme un danger éducatif et moral. L'Education allemande est désaxée. Seule l'U.R.S.S. continue sa marche en avant avec une doctrine sociale qui ne semble pas être parvenue, à ce jour, à promouvoir un processus éducatif original, mais qui cependant apporte une élévation du niveau de culture de la masse.
C'est dans ce vide pédagogique, où essaient de se survivre une Ecole nouvelle contestée et des méthodes actives, objet de bien des malentendus, que la « Pédagogie Freinet » de l'Ecole moderne apparaît aujourd'hui, non seulement en France, mais dans le monde, comme une formule pédagogique d'avenir, avec des pratiques cohérentes, un esprit harmonisateur enthousiasmant, des fondements psychologiques, philosophiques et sociaux qui touchent, pour les rénover, aux bases mêMes de l'Ecole du Peuple, avec des équipes de chercheurs enfin, et d'expérimentateurs dont le dynamisme est garant du succès.
Plus encore qu'en 1920 ou en 1930, une pédagogie moderne doit s'adapter aux changements qui ont bouleversé la vie des peuples, aux incessantes mutations suscitées par la naissance de l'ère atomique, paf la brusque extension d'une démocratisation désormais irréversible.
En France notamment, une réforme, lente à s'ébranler, n'en pose pas moins aujourd'hui des problèmes inéluctables, pour lesquels psychologues, pédagogues, animateurs sociaux, cherchent en vain des solutions.
La « Pédagogie Freinet » de l'Ecole Moderne a la prétention d'apporter les réponses indispensables, et pas seulement des réponses théoriques toujours faciles, mais surtout la preuve que les théories généreuses des grands pédagogues peuvent aujourd'hui devenir réalité, qu'elles le sont déjà dans des milliers d'écoles où-elles ont affirmé
leurs bienfaits et que donc un feu vert est désormais débloqué sur les voies encore cahotiques de l'avenir.
Que sont ces techniques Freinet ? Comment ont-elles pris naissance ? Qui les anime ? Quelles forces lui valent une telle audience, gage des succès à venir ?
C'est ce que nous voudrions exposer brièvement dans cette étude qui se présente comme une sorte de synthèse, les lecteurs intéressés pouvant toujours se documenter dans les livres et revues de Freinet et de ses collabo-teurs (1).
(1) Voir page 2.
COMMENT SE POSE LE PROBLÈME
Pour nous, instituteurs primaires, la pédagogie, c'est la science de la conduite d'une classe en vue d'une instruction et d'une éducation optimales des enfants qui la composent. C'est du moins la définition de bon sens que nous en donnons en fonction de notre propre expérience.
La solution de ce problème dépend certes des ouvriers qui ont la charge de le résoudre. Si ceux-ci sont suffisamment intuitifs et sensibles; s'ils ont équilibre, maîtrise et autorité, ils peuvent exceptionnellement, sans apprentissage spécial, sans techniques ni matériel, et pour ainsi dire par une méthode à eux, parvenir à des résultats très satisfaisants et parfois même exceptionnels, tel Makarenko.
Pendant longtemps, les progrès en pédagogie ont été stoppés parce que, à la base comme au sommet, on prétendait que la pédagogie est un don, et que quiconque aime les enfants et sait se faire respecter a des chances de réussir en pédagogie. Ce qui n'est pas totalement faux. Seulement, le nombre d'éducateurs qui possèdent ces qualités idéales et dont nous n'avons pas à nous préoccuper, est extrêmement réduit. Il ne nous appartient pas d'en augmenter le nombre; et comme il faut malgré tout des éducateurs, force nous est de chercher et de trouver des solutions au moins approchées, qui permettront, aux instituteurs et professeurs de bonne volonté, de faire une honnête besogne, même s'ils n'ont pas au départ les qualités exceptionnelles des maîtres d'élite. Nous laisserons donc de côté la solution idéale, dont nous ne nions ni l'importance ni la portée, pour répondre plus particulièrement à l'attente inquiète des ouvriers de la base désireux d'approche:• au moins de la perfection de leurs maîtres. Nous prétendons d'ailleurs, par ce détour, donner aux éducateurs l'amour de leur métier, donc l'amour des enfants. Ils retrouveront du même coup la sensibilité, l'équilibre, la maîtrise et l'autorité, facteurs essentiels de l'efficience et de la réussite.
Ce faisant, nous nous distinguons des mouvements pédagogiques qui nous ont précédés : c'est sans doute
12
la première fois dans l'histoire de la pédagogie qu'une action de rénovation part ainsi radicalement de la base : Mme Montessori et Decroly étaient médecins ; les psychologues suisses étaient avant tout des penseurs ; Dewey était philosophe. Ils avaient senti, souvent avec génie, l'urgence des options nouvelles que le monde allait nous imposer; ils semaient au vent le bon grain d'une éducation libérée. Mais ce n'étaient pas eux qui grattaient la terre où allait germer la semence, ni qui avaient mission de buter et d'arroser les jeunes plants, en les accompagnant avec sollicitude jusqu'à la fructification. Ils laissaient obligatoirement ce soin aux techniciens de la base qui, faute d'organisation, d'outils et de techniques, ne parvenaient pas à traduire leurs rêves en réalité.
C'est ce qui explique que les meilleures méthodes ne soient pas parvenues jusqu'à ce jour à remuer en profondeur la masse des écoles, et que persiste toujours le décalage ancestral entre les idées généreuses des uns et l'impuissance technique des autres.
Comment se pose le problème pédagogique à l'instituteur qui, sans autre bagage que sa mince culture traditionnelle et sa bonne volonté, se trouve aux prises avec les trente ou quarante élèves de sa classe?
J'ai été et je reste un de ces instituteurs, et c'est pourquoi me sont familières les données pour lesquelles j'ai si longtemps cherché une réponse valable.
Quand nous nous rencontrions, mes camarades et moi, au temps de notre jeunesse, au cours des Conférences Pédagogiques, des Certificats d'Etudes, et des réunions syndicales, nous nous inquiétions certes des aléas de notre métier. Nous le faisions comme autrefois les paysans et les artisans se transmettaient, presque clandestinement, les tours de mains, avec une sorte de pudeur à divulguer leurs faiblesses; comme les ouvriers et les paysans d'avant l'organisation syndicale se plaignaient entre eux, avec plus ou moins de véhémence et d'humour, mais sans oser situer et extérioriser des problèmes que leurs maîtres d'alors jugeaient volontiers mineurs, égoïstes ou révolutionnaires. Les outils de travail — les manuels scolaires
13
plus spécialement — étaient établis en dehors de nous, par des auteurs qui, la plupart du temps, ne faisaient plus classe, selon des programmes établis par les directions et les ministères, et qui ne répondaient qu'accidentellement aux propres besoins de la masse.
A la base, nous n'avions pas voix au chapitre. Nous attendions humblement que d'autres parlent et décident pour nous, comme, avant les organisations syndicales, les ouvriers déléguaient la défense de leurs intérêts à ceux qui, contremaîtres et chefs d'entreprises, avaient le temps et l'instruction nécessaires pour s'occuper, croyait-on, des intérêts des travailleurs (1).
Nous en étions là. Les syndicats eux-mêmes ne plaçaient pas — et ne placent pas encore — les revendications pédagogiques au centre de leurs préoccupations. Ils n'avaient pas encore compris que la libération pédagogique sera l'oeuvre des éducateurs eux-mêmes, ou ne sera pas.
C'est parce que nous avons été nombreux à comprendre cela qu'il existe aujourd'hui, en France et dans le monde, à côté des organisations politiques et syndicales, une sorte de troisième force qui est la conjonction des éducateurs — qui sont souvent, par ailleurs, d'actifs et consciencieux militants syndicalistes et politiques — engagés dans la recherche d'une pédagogie digne de notre époque de démocratisation et de progrès.
(1) « Les essais sont décidés par des hommes qui enseignaient bien, mais qui n'enseignent plus; en partie par d'autres qui enseignaient mal et qui, par cette raison même, ont choisi d'administrer; en partie par les hommes des bureaux qui n'ont jamais enseigné, qui n'en seraient point capables et que je me permets d'appeler les illettrés de l'Instruction publique. Ceux-là sont des sergents-majors en quelque sorte, qui savent un peu de droit routinier et qui administreraient aussi 'bien, ou aussi mal, les bateaux, les écluses, les théâtres, le pain de troupe ou le mobilier national.
« ... Et tout est bien sur le papier.
« Une administration centrale a-t-elle jamais cherché autre chose ? Qu'il s'agisse du Théâtre français, d'un hospice, d'une piscine, d'une prison ou d'une école, ne s'agit-il pas toujours d'ancienneté, d'avancement, de titre de faveurs, de solliciteurs, de crédits, d'économies, d'horaires ? s (Alain, Propos sur l'Education. P.U.F.).
LES DÉBUTS DE NOS TECHNIQUES
Pourquoi et comment me suis-je trouvé à l'origine de ce mouvement ?
Je me garderai bien de m'attribuer un talent spécial qui aurait pu me prédestiner à ce rôle de chef de file. Il s'en est fallu d'ailleurs de fort peu que, tout comme la masse de mes collègues, je me contente de la paisible routine qui conduit à la retraite sans trop d'efforts et de soucis. Quand je suis revenu de la Grande Guerre, en 1920, je n'étais qu'un « glorieux blessé n du poumon, affaibli, essoufflé, incapable de parler en classe plus de quelques minutes. Malgré ma respiration compromise, j'aurais pu peut-être, avec une autre pédagogie, accomplir normalement un métier que j'aimais. Mais faire des leçons à des enfants qui n'écoutent pas et ne comprennent pas — leurs yeux vagues le disent avec une suffisante éloquence —, s'interrompre à tout instant pour rappeler à l'ordre les rêveurs et les indisciplinés par les apostrophes traditionnelles :
— Veux-tu écouter I
— N'as-tu pas fini de claquer tes pieds contre les traverses du banc ?
— Répète ce que j'ai dit...
C'était là peine perdue dàns l'atmosphère confinée d'une classe qui avait raison de mes possibilités physiologiques. Comme le noyé qui ne veut pas sombrer, il fallait bien que je trouve un moyen pour surnager. C'était pour moi une question de vie ou de mort.
Si j'avais eu, comme tant de mes collègues, le souffle suffisamment solide pour dominer de la voix et du geste la passivité de mes élèves, je me serais persuadé que ma technique restait malgré tout acceptable. J'aurais continué à user ma salive, outil n° 1 de ce que nous appelons l'école traditionnelle, en conséquence de quoi j'aurais, très tôt, fini mes expériences.
Il y a donc, à l'origine de mes recherches, la nécessité où je me suis trouvé d'améliorer mes conditions de travail pour une efficacité si possible accrue. Et il y a
15
eu aussi une obstination insensée à honorer un métier que j'aimais et que j'avais choisi.
Une autre caractéristique de mon esprit ou de mes tendances m'a poussé hors des sentiers battus : un besoin comme physiologique et moral d'adhérer à une classe sociale et plus encore à la corporation enseignante reflétant massivement les données d'un milieu dont j'étais partie intégrante. Mon problème se posait de lui-même : trouver le moyen de travailler mieux sans m'isoler de mes collègues.
Quand j'eus découvert l'imprimerie à l'Ecole, j'aurais pu, comme on procède volontiers aujourd'hui, faire breveter mon innovation, faire breveter ensuite, comme Mme Montessori, un matériel qui aurait été à la base de la nouvelle méthode. Mais, ce faisant, je me serais écarté, dès l'origine, de la masse des éducateurs dont je n'aurais plus été qu'exceptionnellement l'expression.
J'ai pris tout de suite une autre direction : au lieu de garder le secret sur cette découverte, je l'ai versée délibérément dans le creuset coopératif. Nous n'étions encore que quelques pionniers, parmi lesquels Ad. Ferrière, quand je constituais déjà une coopérative avec circulaires, bulletin, corevue de textes d'enfants : La Gerbe, échanges de documents, organisation de correspondances intersco-laires, premières rencontres à l'occasion des Congrès de la vaillante Fédération de l'Enseignement. Nous avions déjà rompu le cercle de l'individualisme stérile. Nous avions jeté les bases de notre mouvement pédagogique coopératif.
Mais revenons-en aux débuts de ma vie enseignante : il fallait donc que je cherche, hors de la scolastique, dont s'accommodait tant bien que mal la masse de mes collègues, une solution nouvelle, une technique de travail qui soit à la mesure de mes possibilités réduites.
Je fis alors comme tous les chercheurs. J'adoptai ce même processus de tâtonnement expérimental que nous placerons par la suite au centre de notre comportement pédagogique et de nos techniques de vie. Je lus Montaigne et Rousseau, et plus tard Pestalozzi, avec qui je me sentais une étonnante parenté. Ferrière, avec son Ecole active et la Pratique de l'Ecole active, orienta mes essais. Je visitai les écoles communautaires d'Altona et de Hambourg. Un voyage en U.R.S.S., en 1925, me plaça au
16
centre d'une fermentation quelque peu hallucinante d'expériences et de réalisations. En 1923, je participai au congrès de Montreux, de la Ligue internationale pour l'Edu-cation nouvelle où se côtoyaient les grands maîtres de l'époque, de Ferrière à Pierre Bovet, de Claparède à Cousinet et à Coué.
Mais quand je retournai seul dans ma classe, en octobre suivant, sans soutien et sans l'appui moral des penseurs que j'admirais, je me sentais désespéré : aucune des théories lues et entendues ne pouvait être transposée dans mon école de village. Les seules réalisations valables étaient celles de certaines écoles nouvelles d'Allemagne ou de Suisse, qui, avec un nombre réduit d'élèves et une profusion d'éducateurs de choix, fonctionnaient dans des conditions qui n'avaient rien de comparable à celles que je devais subir. Force m'était de revenir tant bien que mal aux outils et aux techniques traditionnels, de faire des leçons que nul ne comprenait, de faire lire des textes qui, même s'ils étaient simples, ne signifiaient rien dans le devenir éducatif des enfants. C'était, en lecture, la méthode Boscher — en usage encore, à peine modernisée, dans bien des classes — avec son : Papa a ri — Nana a mangé du rata... C'étaient, en calcul, les nombres appris mécaniquement avec .ou sans bûchettes, et, pour toutes les disciplines à enseigner, c'était la leçon de rabâchage qui lassait très vite les enfants autant que moi-même.
Il me fallait, dans ce climat épuisant, me démener, pour essayer, tel un clown sans talent, de retenir un instant, artificiellement, l'attention fugitive de mes élèves.
Les collègues me conseillaient la patience : Tu t'habitueras... Il faut prendre une certaine routine, même un peu somnolente, si tu veux vivre ! Et l'inspecteur ne savait que me vanter les succès étonnants de Mme ou de M. X : Si vous voyiez leur classe ! Ce qui n'était qu'une façon déguisée de me faire sentir mon incompétence professionnelle.
L'IMPRIMERIE A L'ÉCOLE
Une éclaircie pratique et technique dans ce ciel désespérément scolastique : les instituteurs qui militaient dans la Fédération de l'Enseignement essayaient alors, en avant-garde, de faire pénétrer un peu de vie dans leur enseignement. Des expériences de e classes-promenades » avaient été faites. Le mot était évidemment mal choisi, les parents jugeant que les enfants ne vont pas à l'école pour se promener, et l'Inspecteur n'ayant nulle envie de partir à travers champs pour retrouver ses ouailles.
La classe-promenade fut pour moi la planche de salut. Au lieu de somnoler devant un tableau de lecture, à la rentrée de la classe de l'après-midi, nous partions dans les champs qui bordaient le village. Nous nous arrêtions en traversant les rues pour admirer le forgeron, le menuisier ou le tisserand dont les gestes méthodiques et sûrs nous donnaient envie de les imiter. Nous observions la campagne aux diverses saisons, quand l'hiver les grands draps étaient étalés sous les oliviers pour recevoir les olives gaulées, ou quand les fleurs d'oranger épanouies au printemps semblaient s'offrir à la cueillette. Nous n'examinions plus sco-lairement autour de nous la fleur ou l'insecte, la pierre ou le ruisseau. Nous les sentions avec tout notre être, non pas seulement objectivement, mais avec toute notre naturelle sensibilité. Et nous ramenions nos, richesses : des fossiles, des chatons de noisetier, de l'argile ou un oiseau mort...
Il était normal que, dans cette atmosphère nouvelle, dans ce climat non scolaire, nous accédions spontanément à des formes de rapports qui n'étaient plus celles, trop conventionnelles, de l'école. Nous nous parlions, nous nous communiquions, sur un ton familier, les éléments de culture qui nous étaient naturels et dont nous tirions tous, maître et élèves, un profit évident. Quand nous retournions en classe, nous écrivions au tableau le compte rendu de la e promenade s.
Mais ce n'était là encore qu'un coin lumineux enfoncé provisoirement dans le mur de la scolastique. La vie s'arrêtait à cette première étape. Faute d'outils nouveaux et de techniques adéquates, je n'avais d'autres ressources,
18
pour enseigner la lecture d'un texte imprimé, que de dire sur un ton résigné :
— Maintenant, prenez votre livre de lecture page 38 : la Gourmandise (ou toute autre page également étrangère à l'intérêt des enfants et du maître). Et, pendant que nous lisions « La Gourmandise s, nous avions encore dans la tête, vivaces et parlantes, les images de la promenade. Les mots eux-mêmes s'habillaient en fonction des minutes exaltantes que nous avions vécues. Il y avait divorce total, et inévitable, entre la vie et l'école. Le travail auquel nous étions ainsi contraints perdait de ce fait tous les avantages du travail vivant pour devenir une tâche fastidieuse et sans portée.
Enfin un outil
qui change les données pédagogiques de la classe t
l'imprimerie
Je me disais alors :
— Si je pouvais, par un matériel d'imprimerie adapté à ma classe, traduire le texte vivant, expression de la « promenade e, en page scolaire remplaçant les pages du manuel, nous retrouverions, pour la lecture imprimée, le même intérêt profond et fonctionnel que pour la préparation du texte lui-même. C'était simple et logique, si simple que je m'étonnais même que nul n'ait pu y penser avant moi.
J'essayai alors de réaliser mon rêve. Je trouvai heureusement, chez un vieil artisan imprimeur, un petit matériel d'imprimerie avec composteurs spéciaux et presse en bois qui devait, en principe, permettre l'impression de nos textes. En réalité, nous parvenions difficilement à imprimer 5, 6, 7 lignes, de quoi garnir les feuilles 10,5 X 13,5 que nous employions alors.
Je ne m'attendais pas, à ce moment-là, à ce que les élèves puissent se passionner longtemps sur un travail dont je mesurais tout à la fois la complexité et la minutie. J'étais tellement habitué au travail qu'on impose et qui exige l'effort, que je n'imaginais pas que puisse exister effectivement une autre forme d'activité plus allégée et plus agréable.
19
Je me trompais. Les élèves se passionnèrent pour la composition et l'imprimerie, ce qui n'était pourtant pas simple avec notre matériel encore rudimentaire. Ils étaient pris au jeu, non seulement parce que le classement des caractères dans les composteurs pouvait être prenant, mais surtout parce que nous avions retrouvé un processus normal et naturel de la culture : l'observation, la pensée, l'expression naturelle devenaient texte parfait. Ce texte avait été coulé dans le métal, puis imprimé. Et tous les spectateurs, l'auteur au tout premier chef, sentaient à la sortie de l'imprimé comme une émotion, au spectacle du texte magnifié qui
prenait désormais valeur de témoignage. •
' C'était la première découverte de base qui allait permettre de reconsidérer progressivement tout notre enseignement. Nous avions rétabli un circuit naturel obstrué par la scolastique. La pensée et la vie de l'enfant pouvaient désormais devenir éléments majeurs de la culture.
NAISSANCE DU TEXTE LIBRE
Ma trouvaille — mais elle est si naturelle et tellement de bon sens — a été, à ce stade, de me persuader que, quoi qu'on en dise, l'enfant était capable de produire ainsi des textes valables, dignes d'influencer notre scolastique.
Or, rien à l'époque ne m'encourageait dans cette voie.
Quand je montrais naïvement les premiers textes d'enfants sortis de notre presse, si simples et si innocents, mes camarades m'objectaient :
— A quoi bon ? Il y a bien assez de beaux textes d'adultes dans nos manuels, autrement intéressants et utiles que ces balbutiements !...
— D'ailleurs, me disaient d'autres camarades, que veux-tu tirer d'original d'enfants qui sont si totalement à court d'idées quand nous leur donnons une rédaction à faire ? Ils sont là, bouche bée et crayon levé. Il nous faut pour en tirer quelque chose de présentable, non seulement leur préparer ou suggérer des idées, mais parfois même leur donner un s canevas » si ce n'est l'amorce des phrases qu'ils ont peine à compléter...
Les Instructions officielles ne disent-elles pas : e L'exercice de composition française apparaît au Cours élémentaire, mais il n'y apparaît que timidement. Il ne saurait être question de faire composer à des enfants de sept ans de véritables rédactions. Nous ne leur demandons pas même un paragraphe. Nous ne leur demandons que de petites phrases... L'enfant ne peut rédiger que lorsqu'il possède non seulement une assez riche collection d'idées, mais une assez riche collection d'expressions... Que l'enfant apprenne d'abord à exprimér une idée, c'est-à-dire à assembler les éléments d'une proposition, à écrire correctement une phrase simple. Si, au terme du Cours élémentaire, il est rompu à cet exercice, il n'aura pas perdu son temps. »
Au Cours moyen, il apprendra à combiner des phrases. Moins exigeant à cet égard que l'ancien plan d'études, le nouveau conseille aux instituteurs de borner l'effort des enfants de dix ans à la construction d'un paragraphe. Après avoir imaginé quelques phrases sur un paragraphe déterminé, les grouper logiquement en un développement d'une dou-
21
zain ou d'une quinzaine de lignes, voilà tout ce qu'on demande à ces enfants.
Tel était, dans l'enseignement, l'état d'esprit unanime vers 1925. On n'avait jamais vu un texte libre et nul ,ne croyait la chose possible. Il nous a fallu, à force de téméraires expériences, montrer et prouver que l'impossible pouvait devenir étonnante réalité.
Il faut se rappeler ce climat de pessimisme scolastique d'il y a quarante ans, pour mesurer le chemin parcouru, du moins par une portion sans cesse croissante des éducateurs, car nombreux sont encore ceux qui en sont restés à 1925 et qui, en toute bonne foi, vous accuseront d'écrire vous-mêmes les textes de vos élèves. C'est bien à regret que nous voyons, aujourd'hui encore, les pays récemment promus à l'indépendance, bâtir leur système éducatif, non point sur la riche expression libre, mais sur des textes d'auteurs de manuels scolaires périmés.
Les choses ont malgré tout évolué et cela, on nous permettra de le dire, grâce à nos productions et à nos exemples. Le Texte Libre, presque unanimement recommandé aujourd'hui — même s'il n'est pas toujours judicieusement pratiqué — n'en consacre pas moins officiellement cette aptitude de l'enfant à penser et à s'exprimer, et à passer lui aussi d'un état de mineur mental et affectif, à la dignité d'un être capable de construire expérimentalement sa personnalité et d'orienter son destin.
J'avais d'emblée, par intuition et bon sens, fait confiance aux enfants et j'avais eu raison. Si, au départ, je leur avais demandé d'imprimer des textes d'adultes étrangers à leur propre vie, ils se seraient bien vite lassés de la nouveauté que je leur offrais, comme ils se lassent du beau manuel tout neuf que nous leur donnons en octobre. Et notre expérience aurait, dès son départ, avorté peut-être définitivement.
J'avais jeté la graine. J'ai aidé à son éclosion pour démontrer que le besoin de création et d'expression est une de ces idées-forces sur lesquelles peut se bâtir un renouveau pédagogique incomparable.
L'avenir allait nous donner raison.
CORRESPONDANCE INTERSCOLAIRE
MOTIVÉE
MOTIVÉE
Je sentais pourtant que, malgré les premiers succès de l'Imprimerie à l'Ecole dans ma classe de Bar-sur-Loup, la boucle n'était pas encore totalement bouclée. Ces textes produits dans nos classes étaient bien lus dans le village, appréciés d'ordinaire par les parents, mais ce n'était pas encore suffisant. Nos enfants voulaient et méritaient une plus large audience.
A cet effet, je commençai la correspondance inter-scolaire. Dès 1926, mon ami Daniel, de Saint-Phili-bert-de-Trégunc (Finistère) achetait notre matériel et, spontanément, s'engageait à son tour dans l'expression libre.
Une correspondance s'amorçait dont le total succès est à l'origine du développement croissant des correspondances interscolaires, avec ou sans journal scolaire, et des voyages-échanges qui en sont l'heureux complément. Nous tirions de chaque texte vingt-cinq feuilles supplémentaires que nous envoyions tous les deux jours à Saint-Philibert, et nous recevions en échange, avec la même régularité, les vingt-cinq imprimés de leur classe. Ainsi s'est déroulée pendant deux ans, entre deux classes extrêmement pauvres, une correspondance interscolaire qui, pour son coup d'essai, était un coup de maître rarement dépassé depuis.
Nous vivions désormais la vie de nos petits camarades de Trégunc. Nous les suivions en pensée dans leur chasse aux taupes ou leurs pêches miraculeuses, car la mer était venue jusqu'à nous et nous tremblions avec eux les jours de tempête. Nous leur racontions, nous, la cueillette de la fleur d'oranger et des olives, les fêtes de Carnaval, la fabrication des parfums, et notre Provence tout entière s'en allait ainsi vers Trégunc.
Et un jour, grand événement, arriva le premier colis, tel que le décrit L'Ecole buissonnière dans l'une des séquences les plus émouvantes du film. Il contenait, outre les algues et les coquillages, tout un paquet de crêpes délicieuses. Nous en avons mangé, nous en avons fait
23
goûter à la première classe et chaque élève est parti à midi avec une part minutieusement établie à l'intention des parents. Inutile de dire le succès et l'enthousiasme suscités par ce prestigieux colis. Car la réaction des parents ne s'est pas fait attendre. Il faut leur envoyer un colis, vous autres aussi... des oranges, des kakis, des olives, des fougaces. Et le colis pour Trégunc se préparait dans la fièvre.
Une vie nouvelle pénétrait dans nos classes. Nous avions rétabli le circuit : le texte libre devenait page de vie, qui était communiquée aux parents et transmise aux correspondants. Nous avions là la puissante motivation qui allait aiguillonner l'expression libre chez nos élèves.
Il est des usagers actuels du texte libre qui se plaignent parfois encore d'être à court de textes. S'il en est ainsi, c'est sans doute que leur texte libre n'est pas motivé comme il devrait l'être par le journal scolaire et la correspondance interscolaire. Sans ces appuis naturels, l'enfant a l'impression de faire un travail gratuit qui lui rappelle les rédactions scolaires. Le charme n'y est plus. L'enfant n'éprouve pas le besoin d'écrire.
Mais que fonctionnent journal et correspondance, et, comme dans la famille, l'enfant ne se lassera jamais de raconter les éléments de sa vie, et non seulement de sa vie extérieure, mais aussi de toute cette pensée profonde que l'école n'effleure jamais et qui n'en est pas moins, on le sait mieux aujourd'hui, le moteur profond du comportement.
Nous atteignions ainsi, d'emblée, aux fondements sûrs et définitifs de notre pédagogie. Par le rétablissement des circuits de vie, par la motivation permanente du travail, nous dépassions désormais la scolastique pour parvenir à une autre forme, idéale, d'activité qui enrichit et rééquilibre, et prépare ainsi la vraie culture.
Ce qui caractérise en effet la scolastique, c'est l'obligation qui est faite aux élèves, par les règlements, les manuels scolaires et le maître, de produire un travail qui n'a en général pas d'assise dans la vie des individus, et donc, ni ne les touche, ni ne les influence en profondeur. Ce travail n'est pas fonctionnel. II est prévu par les adultes en raison de leur culture d'adultes, et c'est systématiquement qu'on prétend l'isoler de toute vie dans la crainte d'une perte de temps et de manque de sérieux.
LA PÉDAGOGIE
DE L'EXPLICATION SUPERFLUE
L'ennemi n° 1 de la régénération de notre école, c'est l'explication à outrance, la leçon permanente dans laquelle la voix du maître est l'outil majeur de la vie enseignante.
L'expérimentation est lente et capricieuse; elle demande outillage et installation; l'observation elle-même suppose attention et persévérance. L'école a trouvé un raccourci qu'elle a cru efficace : l'instituteur expliquera. S'il n'expliquait que lorsque les enfants eux-mêmes manifestent leur inquiétude devant les problèmes de la vie, il n'y aurait rien à redire. Mais l'explication, devançant expérimentation et observation, est devenue la fonction majeure de l'éducateur.
Cette patience d'atelier, dit Alain, on ne la trouve point dans nos classes, peut-être parce que le maître s'admire lui-même parlant ; peut-être parce que toute sa carrière dépend de ce talent qu'il montre à parler longtemps tout seul ; vraisemblablement aussi de ce que l'enseignement a pour fin de distinguer quelques sujets d'élite, qui arrivent d'eux-mêmes à singer et à inventer.
L'explication devient bien vite verbiage et le verbiage supplée en classe au raisonnement et à l'action; il les supprime et les remplace, au risque de laisser s'atrophier les qualités dont ils sont l'émanation. Selon cette pratique, ce n'est pas l'expression qui primera en français, mais l'explication, les leçons de grammaire et de vocabulaire, comme si on imposait à l'enfant qui fait les premiers pas toute une série de règles et d'interdits préalables : Attention, ne bouge pas... tu risquerais de compromettre les premières acquisitions... Je vais t'expliquer d'abord comment on parle ou comment on marche... Après, mais après seulement, tu feras tes premières armes... Il faut connaître avant de s'essayer à marcher...
L'enfant, victime de telles pratiques, n'apprendrait jamais à parler et resterait muet si la maman avait l'idée contre nature de procéder ainsi, si elle avait la pensée saugrenue d'imposer à son enfant l'étude des lois soi-
25
ger'it du e, le on-
let gazouiller scientifiques tout son langa sagoul avant de , à la conquête laisser naturelle et sûre du langage.
C'est ce processus scolastique contre nature que nous devons dénoncer, et ce sera notre préoccupation essentielle et délicate, car le pédagogue croit déchoir s'il ne place sa fausse science à l'origine de toute connaissance dont l'enfant doit devenir maître; s'il accepte de suivre la nature, les événements, au lieu de prétendre les remplacer.
Dans toutes les matières à enseigner incluses dans un programme dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas intégré à la vie, dans toutes les disciplines, calcul, sciences, histoire, géographie, morale, c'est la leçon du manuel, reprise et commentée par le maître, qui supplée à l'expérience de l'enfant, à sa vision des choses. La leçon faite, automatiquement surgissent les exercices qui doivent confirmer les règles expliquées, alors qu'il aurait été si facile de mettre à la disposition des enfants le matériel et la documentation leur permettant d'arriver par eux-mêmes à la connaissance, en dehors de tout ,« baratin ».
Nous ne disons pas qu'une leçon bien faite, avec toutes les règles de l'Art, soit forcément inopérante. Il y a, dans tout effectif scolaire, une proportion d'élèves particulièrement doués, avec lesquels l'école traditionnelle a des réussites : intelligents, nantis d'une excellente mémoire, aimant le travail, de tels enfants tiennent sans peine la tête de la classe. Ils réussissent avec toute méthode pédagogique, même la plus retardataire. Mais ils réussiraient incontestablement mieux encore si leur était offerte une pédagogie pour enfants sur-doués ne se souciant pas uniquement de rendement intellectuel mais d'acquisitions humaines, artistiques, ne visant pas exclusivement la préparation aux examens mais une manière de science de vivre en liaison permanente avec leur milieu et leur époque.
C'est au-delà du cinquième élève, tête de classe, que la leçon, employée comme technique enseignante, devient inopérante. Les enfants qui n'ont pas cette tendance intellectuelle, qui n'acceptent pas sans mal l'explication abstraite, sont réfractaires à la scolastique prodiguée du haut de la chaire. 90, 95 % des élèves subissent l'ensei-
26
gnement livresque avec effort, perte de temps et d'énergie. C'est pour ces 90 % d'écoliers que nous avons cherché des solutions susceptibles de faire éclore en eux des aptitudes qui préfigurent et honorent l'homme qu'ils seront demain.
La technique actuelle, l'organisation syndicale et politique, le marché du travail, demandent aux adolescents un certain nombre de qualités qui dépassent et débordent l'acquis scolaire traditionnel et dont notre pédagogie du premier degré doit se préoccuper au même titre que la réussite des élèves bien doués. Et là, tout reste à faire. C'est dans ce domaine que nous avons innové, en vue surtout d'un rendement de masse.
Dans un article paru dans l'hebdomadaire L'Express du 2 août 1962, on rend compte d'un Congrès international d'orientation professionnelle, qui s'est tenu à Cachan (Seine) et au cours duquel des psychologues ont examiné le problème de l'orientation des élèves dans une société « mobile » « où il n'y a plus de métiers ».
En voici la conclusion :
« En gros, le travail urgent est celui-ci : obtenir une formation générale d'un degré élevé qui forme plus complètement la personnalité et la rend prête à ,,lusieurs tâches, et non à une seule, et d'autre part débloquer la méfiance des jeunes (et de leurs parents) envers la mobilité du travail, parce qu'aucun doute n'est plus permis : ou l'on bougera, ou l'on restera en plan, sans travail.
Nous avons surtout étudié le premier point : l'orientation vers plusieurs métiers à la fois. Cela conduit à une technique d'orientation nouvelle : donner plus d'importance aux « intéiêts qu'aux e capacités e.
La capacité, c'est, par exemple, une connaissance acquise, un diplôme, une expérience technique donnée. Les « intérêts e, c'est plus diffus, plus secret, plus difficile à tester, mais, si vous voulez, c'est ce qui détermine le plaisir qu'un homme trouve à faire son travail.
Pour orienter un jeune homme vers la mobilité du travail, nous pouvons déjà — premier stade — l'orienter vers un choix, un éventail de travaux différents, qui vont sans doute se présenter à lui dans les années à venir, et pour cela, nous essayons de découvrir quels sont OS différents intérêts.
27
... Ce que nous avons pu observer jusqu'à ce four, c'est que les intérêts ne changent plus, passé un certain âge. Les intérêts se forment dans l'enfance, à l'âge de l'école primaire et de la famille...
Si nous voulons que les hommes de demain ne soient pas handicapés dans la mobilité du travail, il faut deux choses : d'abord que, dès l'enseignement primaire, les enfants se voient offrir la possibilité de développer, sans difficultés, le plus d'intérêts possible. Or, actuellement, ils n'ont à l'école qu'une formation de technique littéraire, aussi bien pour apprendre l'orthographe que le calcul... »
Or, il apparaît de plus en plus que la société actuelle, si elle se glorifie à bon droit de ces « éléments » qu'elle considère comme exceptionnels, ne saurait négliger l'infinie variété des autres formes d'intelligence et d'aptitudes, beaucoup plus répandues, et qu'il suffit de cultiver pour donner certaines aptitudes à la masse des élèves que l'école risque de décourager, mais qui n'en seront pas moins les hommes de demain.
Si les éducateurs prenaient conscience du peu de rendement de leur enseignement, ils verraient eux aussi la nécessité de modifier, de redresser leur technique de travail comme le paysan, pourtant attaché à la faux ancestrale, l'abandonne le jour où il a la possibilité d'acquérir une faucheuse mécanique. Si les instituteurs gardent ainsi leurs vieux outils c'est, d'une part, qu'ils leur supposent encore une efficacité majeure et, d'autre part, qu'on ne leur a pas encore offert des techniques et des outils de remplacement plus pratiques et plus faciles.
Ils sont en effet victimes d'une double illusion. Ils enseigneraient aussi bien, en classe, par des « leçons », comment on apprend à monter à bicyclette. Les élèves seraient, comme il se doit, bras croisés, écoutant les savantes explications du maître. Si celui-ci avait quelque peu modernisé son enseignement, il dessinerait au tableau noir des croquis parlants qui aideraient à la compréhension, ou mieux, il amènerait dans la classe un vélo d'étude, qu'on ne pourrait évidemment pas faire rouler, mais qu'on placerait prudemment sur cale pour que les enfants puissent comprendre le fonctionnement et le rôle des pédales, des freins et du guidon.
— Quand vous connaîtrez bien le vélo, si vous avez
28
écouté mes explications et étudié vos leçons, alors vous saurez rouler...
Un jour donc, toutes notions acquises, l'instituteur attaquerait la deuxième phase de l'apprentissage et placerait le vélo entre les mains de ses élèves.
Si par miracle tous ces enfants roulaient à la perfection, le maître y verrait le triomphe de la scolastique, et s'en féliciterait.
Mais il négligerait ainsi l'apport décisif de la vie, car le succès, en vérité, viendrait d'ailleurs : de l'expérience personnelle de l'enfant qui, après la classe, enfourchant un vélo disponible, s'élance dans la descente, tombe, se relève et recommence inlassablement jusqu'à ce que, par tâtonnement, il ait acquis la maîtrise et la technique de l'équilibre.
C'est peut-être un bien, d'ailleurs, que la leçon traditionnelle soit inefficace, car certaines connaissances théoriques risqueraient de compromettre le processus souverain du tâtonnement expérimental qui est : ajustement, recherche, progression.
Cette loi générale, l'éducateur en néglige trop souvent le caractère impérieux en raison de sa simplicité et de son évidence. C'est pourtant en marchant qu'on apprend à marcher; en parlant qu'on apprend à parler; en forgeant qu'on devient forgeron. Si la scolastique peut parfois faire illusion, c'est à cause justement de l'influence du milieu qui, par une méthode naturelle, pallie les insuffisances fonctionnelles de l'école.
L'intelligence manuelle, artistique, scientifique, ne se cultive point par l'usage des seules idées, mais par la création, le travail et l'expérience.
Une nouvelle forme d'école s'impose.
UNE MÉTHODE NATURELLE
D'ÉDUCATION
D'ÉDUCATION
Armé de ces remarques de simple bon sens, chemin faisant, dans les difficulés de la pratique scolaire de ma petite école de Bar-sur-Loup (A.-M.), j'accédais à deux découvertes qui allaient être à la base d'une pédagogie dont je sentais l'urgence.
Dans l'apprentissage de la lecture surtout, j'étais excédé par les exercices de syllabation, seule méthode qui me semblait alors possible et dont l'aspect rationnel, progressif en apparence, me satisfaisait sur le plan théorique. Quoi de plus normal en effet, que de partir de l'élément simple, la lettre, qui, combinée à d'autres lettres forme les syllabes, les mots, lesquels, ajustés à d'autres mots, forment les phrases ? Le processus semblait inattaquable. Je m'y conformais donc au détriment de ma patience, de ma fatigue et de l'attention inégale des enfants.
Rara ira — Riri a ri
Le vin bouillonne dans la futaille
L'andouille grille sur le feu qui pétille...
Il était manifeste que les enfants ne comprenaient rien à ces phrases-calembours qu'ils enfilaient les unes après les autres, sans égard pour les signes de ponctuation dont il aurait été impossible de définir les rôles. J'étais gêné de ne pouvoir faire sentir à ces enfants, si bêtement soumis à une syllabation sans contenu valable à leurs yeux, le sens de ces mots et de ces phrases. Mais y avait-il là quelque chose à comprendre ? Les élèves les plus futés, ceux qui n'acceptaient pas la passivité tant physique qu'intellectuelle, s'arrêtaient très souvent pour poser des questions inattendues qui me faisaient sentir, mieux qu'une critique fondée, toute la malfaisance d'un tel exercice de lecture.
la pou le a pi co ré la (salade)
— M'sieur qu'est-ce que ça veut dire picoréla ?
Il était évident qu'aucun de mes élèves ne cherchait
30
à aller plus loin qu'une syllabation mécanique, pour eux sans intérêt. L'un comptait ses billes dans sa poche ; l'autre boutonnait et déboutonnait son gilet; quelques-uns, épaule contre épaule, mimaient la barque sur l'eau et Joseph, le plus intrépide de tous, se baissait furtivement à chaque instant : des hannetons s'échappaient de ta poche percée; ils étaient ramassés d'une main preste et, tant bien que mal, l'enfant fautif, tout rouge d'émotion, rattrapait le flot des vocables jetés au vent par ses camarades les plus consciencieux.
an-dou-ille feu-fille gre-nou-ille...
gar-gou-ille fri-pou-ille...
Une telle pratique était pour moi, comme pour mes élèves, d'un ennui mortel. Il fallait trouver autre chose.
Mes succès avec l'imprimerie m'orientaient, heureusement, vers de nouvelles recherches. Malgré l'indigence de ma bourse d'instituteur débutant, je m'attachais à perfectionner et à enrichir mon petit atelier d'imprimerie. J'achetai une police de gros caractères, corps 36, pour les petits. Le menuisier me fabriqua une casse rudimentaire et j'essayai au cours préparatoire ce qui m'avait réussi au cours élémentaire : composer et imprimer les petits événements de la vie de chaque jour. Tout de suite, le monde joyeux de l'enfance entra dans la classe, imposa ses valeurs sensibles et claires, ses inattendus, ses espérances :
Louis est monté sur sa mule
11 était content
11 criait : Hue!
Et la mule trottait.
Paul, ce matin,
a ramassé les olives
tombées sur les draps.
J'ai rêvé
que j'étais un géant.
Je faisais peur
à tout le monde.
Je ne visais pas à une quelconque gradation dans
la rédaction de ces textes. Leur écriture, leur complexité
orthographique suivaient la vie. Le texte était composé, puis
31
 imprimé. Il s'ajoutait alors au Livre de vie (dont nous verrons la genèse et la nature), et continuait la frise d'imprimés amorcée tout au long des murs de la classe.
imprimé. Il s'ajoutait alors au Livre de vie (dont nous verrons la genèse et la nature), et continuait la frise d'imprimés amorcée tout au long des murs de la classe.
Mais mes enfants apprendraient-ils à lire par ce procédé ? Je me le demandais certes avec quelque inquiétude. •Je pensais pour me tranquilliser, d'une part, instinctivement, qu'un travail intéressant ne pouvait que laisser des traces, et, d'autre part, la pédagogie de Decroly notamment, était en train de révéler la portée du globalisme. Je constatais que mes enfants lisaient fort bien, à quelques jours d'intervalle, le texte imprimé, globalement, comme jadis la vieille femme illettrée dans sa petite boutique lisait globalement les noms des mois et des jours qu'elle reclassait sans risque d'erreur dans son calendrier mobile. Mes recherches allaient dans le sens de cette réalité nouvelle; l'expérience vécue, longuement renouvelée et répétée, confirmait mon intuition. Une méthode naturelle de lecture était née, qui supprimait le b - a ba et qui, comme l'apprentissage du langage par l'enfant, partait exclusivement de la vie, de l'expression de cette vie qui, ici, dans la classe, se fixait, par l'imprimerie, en textes nets et définitifs.
La correspondance, même à ce degré, allait compléter la méthode (1).
Et je faisais du même coup une autre découverte. De toute évidence, avant l'emploi de l'imprimerie, mes élèves ne s'intéressaient jamais profondément à la classe. J'avais bien essayé quelques-uns des procédés dont on vantait les mérites dans les classes nouvelles. Nous avions ramassé de l'argile et réalisé des modelages plus ou moins artistiques; dans un coin de la classe, un métier à tisser rudimentaire, de notre fabrication, nous permettait un semblant de résultat. Nous tressions des joncs et faisions des paniers, nous nous essayions au moulage d'insectes et de plantes, etc. Tout cela rendait l'école moins austère, mais restait pour ainsi dire en marge de notre véritable vie. Or, c'est cette vie qui importait et qu'il nous fallait retrouver. Ce sont les enfants qui, inlassablement, dans les activités d'une classe où chacun peut en
(1) Méthode naturelle de Lecture, Ed. de l'Ecole Moderne, Cannes (Collection Bibliothèque de l'Ecole Moderne).
32
FREINET : Ln Techniques. — 2
DES TECHNIQUES DE TRAVAIL
On nous excusera pour ce long préambule qui familiarisera le lecteur avec la genèse et les principes essentiels d'une pédagogie qui n'est pas sortie toute armée d'une conception théorique de l'éducation, mais qui est le résultat, redisons-le, d'un long tâtonnement expérimental qui s'est poursuivi au long des années.
Cette pédagogie, nous n'en avons point fixé les contours une fois pour toutes; nous ne l'avons pas érigée en méthode dont il faudrait suivre les règles et les prescriptions; nous l'avons découverte et promue, en praticiens conséquents et conscients, qui, ayant reconnu les tares graves des pratiques éducatives traditionnelles, leur ont, coopérativement, cherché des remèdes. Le chantier était ouvert. Il s'agissait avant tout d'entrer dans la pratique du travail scolaire.
Nous n'avons pas renouvelé l'erreur de ces agronomes officiels qui, au début du siècle, parcouraient les campagnes pour prôner aux paysans les vertus des nouvelles conceptions culturales. Ils parlaient bien, certes, mais ils oubliaient d'agir, de faire la démonstration de la valeur patente des techniques proposées. D'où refus et scepticisme des masses villageoises. Mais un jour, un illuminé a, sans rien dire, amené au village un tracteur encore rudimentaire qui prétendait remplacer la vieille charrue traînée par des boeufs. Un demi-fou! disait-on. Comme s'il était possible de se passer de l'araire qui a fait vivre tant de générations paysannes! Pourtant, de loin, les curieux, sans avoir l'air d'y accorder une quelconque importance, considéraient le sillon. On discuta de l'aventure à la veillée et, au printemps, on regarda le blé pousser. Comme il était droit et dru, on commença à s'enquérir des conditions d'achat et de fonctionnement de la mécanique nouvelle. Et c'est ainsi qu'un deuxième original imita l'illuminé. Du coup, l'événement apparut déjà comme moins téméraire. Les vieux restaient naturellement hostiles : Mener mes boeufs, ça me convient, mais me fier à cette machine pétaradante qui marche quand elle veut et que je ne saurai jamais conduire, non ! Les jeunes, par contre, ouvrirent
34
l'oeil. Ils vinrent essayer la machine, tracer quelques sillons et ils s'en retournèrent convaincus : ça rendait!
Toute théorie préalable était superflue, seul comptait le besoin ressenti par tous d'améliorer les conditions de travail pour un meilleur rendement. Les premières machines, encore imparfaites, allaient se perfectionnant avec la participation efficace des usagers eux-mêmes. Après le tracteur, le jeune paysan mis en goût acheta la faucheuse, puis la remorque pour le transport du foin, la semeuse, puis la moissonneuse. Il vendit alors les boeufs qui devenaient inutiles et changea l'étable en garage. Et du coup, sans aucun discours moral ou social, les conditions de vie elles-mêmes se trouvaient modifiées : le paysan gagna mieux sa vie avec moins de fatigue; il redressa l'échine et leva la tête. Juché sur sa machine, il prit l'air triomphant de l'homme qui est en train de se rendre maître de la nature autour de lui et qui trouve loisirs et temps de réfléchir à son destin, de siffler et de chanter aussi.
Certes, la machine n'apporte pas automatiquement au paysan la libération dont il rêve. Elle lui procure du moins les conditions de base de cette libération. A lui de faire ensuite les efforts collectifs et personnels qui lui permettront de faire servir machine et technique à la culturè, à ses profits, à l'amélioration de la condition paysanne.
Nous sommes partis, dans notre humble école de village, sur des données expérimentales analogues. Nous avons mis au point outils et techniques nouveaux. L'épreuve est décisive : ou bien ces outils et ces techniques permettent meilleur travail, plus grand rendement et sécurité et, automatiquement, sans propagande ni publicité spéciale, ils pénétreront dans les classes et y transformeront le climat et la vie; ou bien ils échouent, et la tradition se perpétuera.
· C'est parce que nos outils et nos techniques permettent effectivement du meilleur travail, que leur succès est -assuré. Aucune théorie hostile, aucune réglementation arbitraire, aucune interdiction ne sauraient empêcher une évolution irréversible. On peut certes l'entraver et la pervertir en retardant ainsi le progrès. On peut l'aider et l'accélérer, si la société elle-même prend conscience de la nécessité d'une modernisation de sa production et de sa culture.
Il n'y a qu'une chose qui peut gêner et compromet-
35
tre cette évolution : le manque de préparation des ouvriers à l'emploi de ces outils dans le cadre d'une technique souhaitable.
Il ne suffit pas, en effet, de laisser faire. Le paysan ne tirera rien de ses machines s'il est brusquement livré à ses propres moyens en face de la nouveauté. Il a été habitué à soigner et à conduire des boeufs, au rythme des boeufs. La machine le déroute et l'effraie et cela se comprend. Mais, soucieux d'un bon départ, il ira prendre des leçons chez ceux qui, déjà équipés, ont su tirer avantages du nouvel outil. Le vendeur intéressé se mettra d'ailleurs à sa disposition pour une initiation au moins rudimentaire. Et, ce qui est mieux, des stages seront organisés par les services agricoles pour la pratique régulière des techniques modernes. Les progrès agricoles en seront accélérés.
Nous souffrons plus encore que les paysans de ces difficultés d'initiation, parce que notre métier est le plus délicat et le plus difficile des métiers. Nous ne remuons pas la terre muette, mais la matière vivante avec laquelle nous ne pouvons pas nous permettre malfaçons et échecs. Le processus n'en restera pas moins identique.
On a regardé avec scepticisme les premiers « illuminés » donner la parole aux enfants, manoeuvrer la presse et sortir leur journal. Et puis, les plus audacieux ou ceux qui se trouvaient dans les conditions les plus favorables ont été « accrochés » à leur tour, et si la nouveauté leur paraissait rentable, ils l'introduisaient dans leurs classes. Mais beaucoup hésitaient, non sans raison. Ils voulaient être sûrs de ne pas faire fausse manoeuvre. Ils voulaient voir par eux-mêmes, expérimenter, essayer.
Pour les décider, il faudrait évidemment, si on juge l'expérience intéressante, envoyer sur place, auprès des indécis, un technicien itinérant qui éviterait aux novices les erreurs décourageantes, organiser stages et cours, en un mot donner sécurité et confiance.
Ce sont là des démarches qui ne sont pas de toute facilité car il faudrait aussi modifier la structure et l'organisation des classes pour que ces techniques, reconnues comme bénéfiques, puissent être généralisées, pour le progrès constant de l'éducation. C'est pourtant ce que nous avons tenté de faire. C'est précisément pour faciliter la marche de ce progrès que nous parlons, pour notre pédagogie,
de « Techniques Freinet » et non de « Méthode Freinet '.
La méthode, c'est un ensemble définitivement monté par son initiateur, qu'il faut prendre tel qu'il est, l'auteur seul ayant autorité pour en modifier les données. La méthode Montessori en est un prototype. Elle est encore aujourd'hui ce qu'elle était en 1930, et c'est pourquoi elle est dépassée.
Nous n'avons jamais eu la prétention de fixer un tel cadre, au contraire. Nous offrons aux éducateurs en difficulté dans leurs classes, des outils et des techniques longuement expérimentés qui sont susceptibles de leur faciliter le travail pédagogique. Nous leur disons : voilà ce que nous faisons avec ces outils, selon ces techniques, voilà ce que nous obtenons, voilà ce qui ne va pas encore, voici ce qui nous enchante. Peut-être ferez-vous mieux, auquel cas nous serons très heureux de bénéficier à notre tour de votre expérience.
Les Techniques Freinet ne sont pas en 1965 ce qu'elles étaient en 1940 parce que de nouveaux outils et de nouvelles techniques sont venus enrichir et faciliter notre travail. Elles ne seront pas en 1970 ce qu'elles sont aujourd'hui, si nous sommes en mesure de continuer, ensemble, les progrès techniques- indispensables.
L'Ecole moderne n'est ni une chapelle, ni un club plus ou moins fermé, mais un chantier d'où il sortira ce que tous ensemble nous y construirons.
UN ESPRIT FREINET
Mais, nous dira-t-on peut-être, la pédagogie ne saurait se réduire à l'emploi plus ou moins justifié ou inconsidéré
des outils, et les Techniques Freinet n'auraient certainement pas l'audience nationale et internationale dont elles bénéficient, si elles n'étaient que cela.
Oui, il y a un esprit des Techniques Freinet, et flous le considérons comme essentiel. Mais cet esprit de-
vrait naître comme automatiquement de l'emploi de nos outils, si nous n'étions pas déformés au point de les employer à contresens. C'est une chose qui ne risque pas d'advenir au paysan non subjugué par sa technique. Il n'ira pas mettre sa faucheuse en marche dans un blé en herbe, ni lancer le tracteur dans le champ de blé mûr... L'emploi de la machine se fait conformément à l'expérience et au bon sens.
Ce qui complique pour nous la question, c'est que les méfaits de la scolastique ont annihilé chez les éducateurs cette intuition directrice qui leur éviterait les erreurs. De ce fait, une initiation préalable est nécessaire pour éviter les déviations regrettables au cours d'une rééducation difficile dont on nous laisse pour l'instant la responsabilité.
Une chose est du moins certaine : en changeant les techniques de travail, nous modifions automatiquement les conditions de vie scolaires et parascolaires; nous créons un nouveau climat; nous améliorons les rapports entre les enfants et le milieu, entre enfants et maîtres. Et c'est peut-être l'aide la plus efficace que nous apportons au progrès de l'éducation et de la culture.
Les éducateurs restent cependant inquiets au moment d'entreprendre un changement qui modifie et leur état d'esprit et la pratique scolaire. Ils ont trop entendu dire que nous préconisons une totale liberté plus ou moins synonyme d'anarchie et ils se demandent s'ils vont, en nous suivant, maintenir dans leur classe la nécessaire discipline.
Rassurons nos collègues. Nous connaissons comme eux la nécessité d'une atmosphère d'ordre et d'équilibre et nous ne recommandons jamais des pratiques qui, en incitant au désordre et à l'anarchie, risqueraient
38
de compromettre l'harmonie qui doit régner dans une classe digne de ce nom. Ce n'est pas nous qui avons lancé des mots d'ordre suspects de liberté inconditionnelle des enfants. La responsabilité en revient à des théoriciens sans enfants ou à des éducateurs exceptionnels, placés dans des conditions particulièrement favorables de travail et d'effectifs. Nous avons toujours eu des classes officielles difficiles, avec toutes les limitations et les oppositions que leur nature d'écoles publiques .comporte. Nous avons eu longtemps contre nous les règlements et l'Administration, parfois même les parents, dominés par la hantise des examens. C'est dans ce complexe délicat que nous avons prudemment innové, non sur des principes mais sur les réalités de nos conditions de travail.
Nous sommes donc partisans d'une discipline scolaire et de l'autorité du maitre, sans lesquels il ne saurait y avoir ni instruction, ni éducation.
Mais quelle forme d'autorité et de discipline nous recommandons, comment nous pouvons y parvenir, c'est ce qu'il faut préciser.
Disons en attendant les explications techniques qui
suivront — que la vraie discipline ne s'institue pas du dehors, selon une règle préétablie, avec son cortège d'interdits et de sanctions. Elle est la conséquence naturelle d'une bonne organisation du travail coopératif et du climat moral de la classe. L'expérience nous a montré que lorsque la classe est bien structurée, quand les enfants ont tous, individuellement ou en groupe, un travail intéressant qui s'inscrit dans le cadre de la vie de la classe, nous parvenons à l'harmonie presque idéale. Il n'y a de désordre que lorsqu'il y a faille dans l'organisation du travail, lorsque l'enfant n'est pas accroché par une activité qui répond à ses désirs et ses possibilités. C'est un des avantages majeurs de nos techniques de régler définitivement le' problème de la discipline scolaire, en créant un milieu éminemment éducatif et humain. Nous en marquerons l'évidence au cours des pages qui suivent.
Je conclurai cette trop longue introduction par une sorte de justification des principes qui y sont inclus : ces principes en effet ne sont pas restés de simples principes-
39
pensées. Ils se sont changés en actes favorables à la grande masse des éducateurs devenus progressivement militants d'une pédagogie rénovée.
C'est pour donner tout son bon sens à cette pédagogie que je m'étais orienté, dès le début, vers le travail coopératif. Les quarante ans qui se sont écoulés depuis nos humbles essais de Bar-sur-Loup, ont vu éclore, sans nul doute, une des plus vivaces parmi les entreprises éducatives de notre siècle — non pas tant par le chiffre des affaires traitées dans des conditions qui étaient toujours un défi aux plus élémentaires notions commerciales, mais surtout par la multiplicité des activités coopératives que nous avons animées :
équipes de correspondance interscolaire;
organisation du travail pédagogique permanent;
création de l'école Freinet, école expérimentale de no-
tre mouvement pédagogique;
cinq mille journaux scolaires paraissant régulièrement
en France et à l'étranger;
réalisation de la Gerbe, corevue d'enfants, et de la
première revue d'Art enfantin;
revues pédagogiques où se poursuivent les discussions
coopératives;
éditions diverses;
expérimentation et production des outils nouveaux
qui pénétreront bientôt dans toutes les écoles.
Elise Freinet a raconté l'aventure de cette audacieuse et humble épopée collective, dans son livre : Naissance d'une pédagogie populaire p (Ed. de l'école moderne) (1) que nous recommandons à nos lecteurs car il est le livre des bonnes volontés et de l'action patiente, dans les données de la vie scolaire.
(1) Le présent livre n'entre pas dans tous les détails de nos techniques. Il vise d'abord, et surtout, à répondre aux questions que se posent et que nous posent les éducateurs et les parents, inquiets de la détérioration accélérée de la fonction éducative. Nous avons insisté un peu longuement sur l'origine de nos techniaues, pour en faire comprendre les fondements et l'originalité.













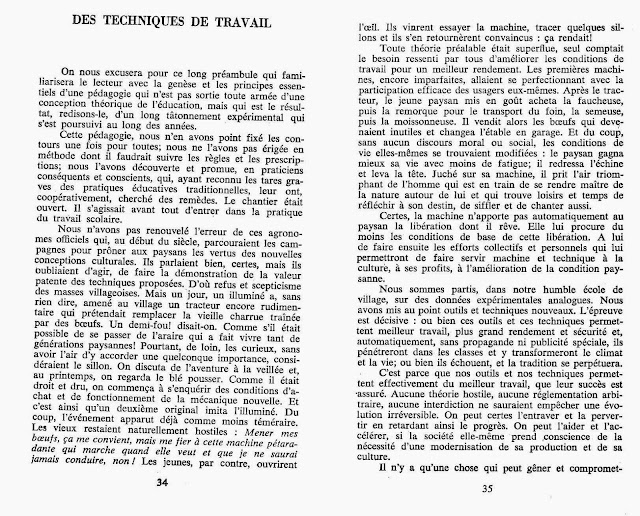



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire